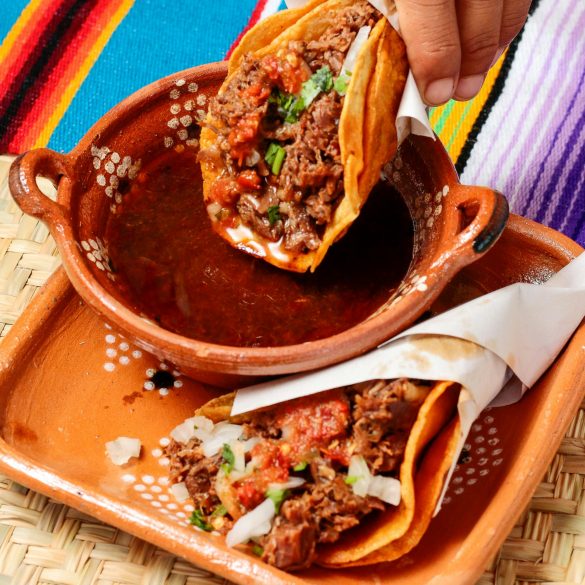Comment le Salvador a mis fin à la criminalité : au cœur de la chute de la criminalité la plus drastique de l'histoire
Soyons honnêtes : il y a cinq ans, si on m’avait dit que le Salvador deviendrait la nouvelle réussite de l’Amérique latine en matière de lutte contre la criminalité, j’aurais éclaté de rire. À l’époque, ce petit pays d’Amérique centrale affichait un taux d’homicides si astronomique qu’il faisait la une des journaux du monde entier chaque mois. Les « zones interdites » aux touristes étaient quasiment des villes entières ; mes amis salvadoriens vivant à l’étranger parlaient d’un endroit qu’ils adoraient, mais qu’ils redoutaient sincèrement de visiter. En tant que conseiller en sécurité urbaine et ayant passé des années à analyser les tendances sécuritaires du Mexique à la Colombie, je pensais avoir vu toutes les versions du pendule « répression contre chaos ». J’ai même publié des articles sur la façon dont les « chutes miraculeuses » de violence se dissipent généralement rapidement, et ont souvent des conséquences cachées brutales.
Alors, comment le Salvador a-t-il défié l'histoire ? Pourquoi, en 2025, les médias grand public, les groupes de réflexion sur la sécurité et, curieusement, même les réseaux de nomades numériques parlent-ils désormais de San Salvador comme d'une destination sûre, autrefois impensable ? Qu'est-ce qui a réellement changé, qu'est-ce qui est mal compris, et quelles leçons (ou mises en garde) le monde devrait-il tirer de la descente vertigineuse du Salvador, de capitale du meurtre à, apparemment, un modèle d'ordre ?
C'est ce que je souhaite décrypter ici. Comme toujours, la réalité est plus complexe – et, franchement, plus surréaliste – que les gros titres (« de l'enfer au paradis en cinq ans ! ») n'osent le suggérer. Ce qui m'enthousiasme : être honnête sur les mécanismes, les politiques, les coûts humains, les risques et les avantages qui persistent. C'est une histoire que tout décideur politique, citoyen ou voyageur devrait lire avec un esprit sceptique mais ouvert. Décryptons-la : humains, politique, réformes, et tout le reste.
Comment le Salvador en est-il arrivé là ? Un décor propice au miracle… ou à la catastrophe
Avant d'aborder les changements, prenons le temps de nous arrêter. Du début des années 2000 à 2015, la réputation du Salvador était presque apocalyptique. Le taux national d'homicides, parfois supérieur à 100 pour 100 000 habitants, faisait la une des journaux, le qualifiant sans équivoque de « pays non en guerre le plus meurtrier au monde ». On ne saurait trop insister sur le poids de cette étiquette, non seulement sur les agendas politiques, mais aussi sur la vie quotidienne. En 2016, se promener dans les quartiers historiques de San Salvador était tendu, même en plein jour. Les chefs d'entreprise avec lesquels je me suis entretenu ont décrit des coûts de sécurité qui engloutissaient un quart de leur budget. Des familles « taxées » par les gangs locaux (les tristement célèbres) maras) ont été confrontés à des choix déchirants : payer, tout risquer ou fuir. Je dois admettre que le sentiment de résignation était palpable. Tout le monde parlait de « normaliser » la menace.
La situation est devenue si grave qu’en 2015, la pression migratoire vers les États-Unis a atteint un pic ; une part importante des mineurs non accompagnés de la tristement célèbre « crise des migrants d’Amérique centrale » fuyaient les territoires des gangs salvadoriens.2 Les efforts d'aide internationale, notamment la formation des policiers et les programmes d'emploi pour les jeunes, n'ont guère contribué à réduire le taux d'homicides. Franchement ? L'état d'esprit des réformateurs urbains était à l'épuisement et au désespoir.
Qu'est-ce qui a changé en 2019 ? L'ascension de Nayib Bukele
Alors, qu'est-ce qui a changé ? La réponse, en un mot : Bukele. Lorsque Nayib Bukele a accédé à la présidence salvadorienne en 2019 – iPhone en main, machine de campagne Twitter et discours de « perturbateur extérieur » – la plupart des observateurs s'attendaient à une nouvelle vague de rhétorique populiste. Ce qui m'a le plus frappé, ayant suivi des dirigeants similaires en Amérique latine, c'est la rapidité avec laquelle la forme est devenue réalité : son administration a entamé une vaste refonte de la sécurité, passant des « pactes avec les gangs » précédents (tentés – et échoués – en 2012-2015) à une approche plus conflictuelle et numérique. Soudain, le discours était « pas de négociations, juste des résultats ».
Au début, la plupart des analystes internationaux, moi y compris, étaient profondément sceptiques.4 Comment un dirigeant pourrait-il « mettre fin à la criminalité » là où des décennies de programmes communautaires, d'aide policière et même de transactions clandestines entre gangs avaient échoué ? Le premier « Plan de contrôle territorial » de Bukele a renforcé la présence policière, investi dans une nouvelle surveillance numérique et lancé une campagne de communication massive, publiant chaque arrestation sur les réseaux sociaux. Les critiques ont dénoncé un culte de la personnalité imminent, tandis que les partisans ont salué cette campagne de communication pragmatique. C'est là que je l'avoue : j'ai sous-estimé le pouvoir du récit et d'une action acharnée et visible. Cela a commencé à changer l'ambiance, du moins dans les centres urbains. Pourtant, je doutais que cela change fondamentalement la donne.
La répression massive et « l’état d’exception » : jusqu’où peut-on aller ?
En mars 2022, tout a changé, radicalement. Contrairement aux réformes fragmentaires et aux trêves entre gangs maladroites du passé, le gouvernement de Bukele a déclaré un vaste « état d'exception » – de fait, un état d'urgence – qui a suspendu l'habeas corpus et conféré à la police et à l'armée de vastes pouvoirs.6 La justification ? Une vague choquante de meurtres de gangs en un seul week-end. (Certains appellent cela le prétexte qui a permis une répression qui a mis des années à se préparer. C'est un débat interminable et, honnêtement, toujours irrésolu pour moi.)
Je me souviens avoir vu les réseaux sociaux regorger de vidéos de smartphones : des camions blindés sillonner les rues, des barrages de police à presque tous les grands ronds-points de San Salvador, des rafles massives de membres présumés de gangs. Il ne s'agissait pas d'une répétition des précédentes campagnes de répression contre la criminalité ; c'était bien plus vaste, plus rapide et, franchement, plus controversé. En quelques mois, plus de 70 000 Salvadoriens ont été arrêtés, souvent sans mandat ni procédure régulière.7 Les organisations de défense des libertés civiles ont crié au scandale. Des voix de confiance au sein de mon propre réseau professionnel ont demandé : « Allons-nous troquer une forme de violence contre une autre ? »
Décomposons les mécanismes opérationnels. Si vous souhaitez un mode d'emploi (que, franchement, j'hésite à détailler), voici l'essentiel :
- Opérations de police militarisées à l’échelle nationale dans chaque district, appuyées par des données de surveillance numérique en temps réel (reconnaissance faciale, traçage mobile).8
- Détention provisoire massive, avec de nombreux suspects détenus pour des accusations « associatives » – souvent pour des tatouages de gang ou une affiliation présumée – avec un recours juridique limité.
- Expansion rapide et centralisation du système pénitentiaire, y compris l’ouverture de la plus grande prison du monde (CECOT) pour accueillir des dizaines de milliers de personnes dans ce qu’on appelle la « sécurité totale ».9
- Messages publics incessants : diffusion d'images de gangs capturés sur Twitter du gouvernement, patrouilles nocturnes diffusées en direct et (ce qui est crucial, selon des entretiens avec des amis sur le terrain) les communautés signalant des activités criminelles avec un sentiment de renversement soudain de l'impunité.
Était-ce légal ? Était-ce éthique ? En fait, permettez-moi de clarifier – même de nombreux partisans l’admettent discrètement : pas toujours. Les juristes constitutionnels sont plongés dans un débat permanent, et la Cour suprême (sous l’influence écrasante de l’exécutif) a fourni juste assez de couverture juridique pour permettre à la répression de se poursuivre sans interruption.10
Le Salvador a-t-il vraiment mis fin à la criminalité ? Regardons les chiffres (et la réalité)
Venons-en maintenant au cœur du problème : la criminalité a-t-elle réellement disparu ou simplement muté ? Les données sont, selon la personne à qui l'on fait confiance, à la fois stupéfiantes et controversées. Le taux officiel d'homicides, selon les chiffres du gouvernement et de plusieurs tiers pour 2024, a chuté à moins de 6 pour 100 000.11 Parmi les plus bas de l'hémisphère. Pour rappel, c'est moins qu'à Chicago, moins qu'au Mexique et comparable à celui du Costa Rica. Le déclin n'a pas été progressif : il a été brutal, amorcé avec le « Plan de contrôle territorial » de Bukele, mais s'est accéléré après les détentions massives de 2022.
| Année | Homicides/100 000 | Meurtres liés aux gangs | Arrestations massives |
|---|---|---|---|
| 2015 | 105 | ~70% | quelques (ad hoc) |
| 2018 | 51 | ~60% | modéré |
| 2022 | 18 | ~35% | 50,000+ |
| 2024 | 5.7 | <10% | 76,000+ |
Mais c'est là que je commence à hésiter. Presque tout le monde – de Human Rights Watch au Département d'État américain en passant par l'ONU – prévient que ces baisses ont un prix. Des arrestations arbitraires, des disparitions et au moins 200 décès en détention ont été recensés.12 Certains « quartiers réputés sûrs » font état d’un dividende sécuritaire, mais les zones rurales ou marginales connaissent encore des disparitions et des abus.
À quoi cela ressemble-t-il maintenant sur le terrain ?
J'ai récemment rencontré des entrepreneurs et des amis de la société civile (quelle différence avec il y a cinq ans !). Ils disent que la présence policière est omniprésente, que l'extorsion à ciel ouvert a disparu du centre-ville et que le tourisme est, curieusement, devenu « cool ». La première expérience mondiale de « Bitcoin Beach » attire les passionnés du Web3.13 Les jeunes peuvent passer du temps dans les parcs après la tombée de la nuit, et même le street art est redevenu un symbole de fierté locale. L'ambiance est étrangement calme, mais à quel prix caché ? Et est-ce durable ? Nous approfondirons la question dans la section suivante.

Coûts, controverses et débats inconfortables
C'est là que les choses se compliquent – et, pour être honnête, cela me rend plus inquiet que n'importe quel « projet » de politique. La leçon la plus dérangeante du miracle salvadorien en matière de criminalité est peut-être la suivante : de grands progrès en matière de sécurité peuvent s'accompagner de compromis éthiques majeurs. (Et, soyons francs, aucun pays ne devrait les adopter à la légère.)
- Détentions massives et droits de l’homme : Les ONG signalent plus de 14 000 « arrestations arbitraires », des détenus étant maintenus en détention pendant des mois sans procès. Plusieurs tribunaux ont constaté des cas de torture ou de conditions de détention inhumaines (dans certains cas choquants, le manque de nourriture ou de soins médicaux ayant entraîné la mort).15
- Dissidence réprimée : Plusieurs groupes de défense de la liberté de la presse et correspondants étrangers (j'ai parlé à plusieurs d'entre eux en privé) décrivent des « visites » policières secrètes dans des médias critiques, un harcèlement ciblé sur Twitter/X et des menaces juridiques continues contre les politiciens de l'opposition.16
- Indépendance judiciaire : La révocation des juges de la Cour constitutionnelle en 2021 a marqué un pas décisif vers la domination de l’exécutif ; les critiques affirment que cette concentration du pouvoir permet la persistance de zones grises juridiques.17
Il est facile pour les observateurs extérieurs de qualifier ces mesures de draconiennes. Pourtant, en discutant avec les Salvadoriens des deux côtés, la réaction massive – notamment parmi les classes populaires et les communautés urbaines – s'est traduite par une reconnaissance (avec une peur sous-jacente). Comme me l'a confié un chauffeur de taxi en avril 2024 : « Oui, je connais des amis qui ont disparu pour rien, mais aussi, mes enfants peuvent aller à l'école sans payer les gangs. Alors, comment puis-je en juger ? » Dans la réalité, pour la plupart des gens, la réponse est tout sauf tranchée.
La violence est-elle simplement passée sous silence ? Certains journalistes d'investigation le pensent. Selon un rapport du Washington Office on Latin America de 2024, une partie de l'extorsion a été transférée vers des mécanismes informels et moins visibles, tandis que les homicides ont indéniablement diminué (beaucoup trop pour être simulés).18
- Violence visible : en forte baisse
- Abus invisibles : en hausse, mais beaucoup plus difficiles à documenter
- La peur des gangs : remplacée par la peur de la détention arbitraire, pour une minorité significative
D'autres pays peuvent-ils copier le Salvador ? Repères, enseignements et avertissements
C'est la question à un million de dollars, non, à un milliard de dollars. Des responsables politiques du Honduras, de l'Équateur et même du Mexique (sans parler des élus municipaux de Washington à Johannesburg) se sont rendus à San Salvador pour demander : « Pouvons-nous faire la même chose ? » Mes appels de consultants et mes discussions en direct ont doublé avec des demandes similaires depuis début 2024. La réponse ? C'est compliqué.
| Pays | Modèle de criminalité | Tentative de copie ? | Résultats à ce jour |
|---|---|---|---|
| Honduras | Répression massive | Partiel (2023) | Réaction croissante; mixte |
| Équateur | Décret d'urgence | Oui (2024) | L'escalade de la violence à ce jour |
| Mexique | Militarisation localisée | Non (débat uniquement) | Le crime organisé persiste |
Le problème, c'est que le copier-coller ne fonctionne jamais. Le « succès » du Salvador repose sur un mélange d'ingrédients unique :
- Géographie et population réduites (plus faciles à saturer avec un appareil de sécurité)
- Structures de gangs centrées sur les zones urbaines (les gangs avaient un « territoire » vulnérable à une prise de contrôle rapide)
- Popularité sans précédent des dirigeants (Bukele reste le dirigeant le plus populaire au monde, selon les sondages)
- Investissement massif dans la surveillance numérique, avec de vastes contrats de fourniture de technologies aux États-Unis19
Le verdict ? Pas de solution miracle. Si vous êtes un décideur politique, un journaliste ou un citoyen en quête d'un remède miracle contre la criminalité urbaine, détrompez-vous.
En fait, laissez-moi revenir en arrière ! Là sont Des leçons transposables, mais qui ne correspondent pas à ce qu'on pourrait imaginer. Nous conclurons avec celles-ci.
Conclusion : dures vérités et véritables leçons de l'effondrement de la criminalité au Salvador
Alors, le Salvador a-t-il « mis fin à la criminalité » ? Pour le dire crûment : la criminalité violente visible a chuté à des niveaux que personne – moi y compris – n'aurait cru possibles. Les espaces publics ont été reconquis et des quartiers entiers sont passés de la terreur à une paix relative. Mais l'histoire n'est ni claire ni parfaitement transposable. L'incarcération de masse, les excès de pouvoir de l'exécutif et les nouvelles formes de contrôle invisible sont réels, tout comme les progrès réalisés. À vrai dire, ce qui s'est passé au Salvador est une expérience sociale sans résultat probant.
Voici ce que j'ai appris (et je suis encore en pleine réflexion) : toute société aspirant à la sécurité est susceptible d'accepter presque n'importe quelle mesure, jusqu'à ce qu'elle la touche, elle ou ses proches. L'épreuve du temps approche : le Salvador pourra-t-il instaurer une véritable justice, des tribunaux indépendants et une surveillance policière honnête avant que les vieilles habitudes (ou les nouveaux abus) ne reviennent ?
- Privilégier une évaluation indépendante : toute réforme radicale nécessite un suivi externe rigoureux, assuré par des agences locales et internationales. La transparence des données devrait être un impératif.
- Investir tôt dans la justice et la réhabilitation : les programmes de prévention de masse, la formation professionnelle et le soutien ciblé aux jeunes sont essentiels à la longévité.
- Protéger les droits civiques, même en temps de crise : la sécurité obtenue en fermant la démocratie n’est qu’une autre forme d’instabilité, différée.
- Reconnaître les conditions locales : ce qui fonctionne dans un petit pays, dense et saturé numériquement peut échouer complètement ailleurs. Le contexte est primordial.
Mon conseil aux urbanistes, maires ou militants désireux de reproduire le « miracle » du Salvador : ne vous fiez pas aux gros titres superficiels. Analysez les données et les témoignages, exigez des réformes durables et n'oubliez pas : toute réforme implique des compromis. La véritable victoire réside dans la construction d'une société qui, un jour, n'aura plus besoin de répression.
J’apprends encore, je suis encore déchiré, mais convaincu que cette affaire – non dénuée de défauts et de dangers – contient des leçons qu’aucun autre pays ne peut se permettre d’ignorer.
Références
- 1 Profil du Salvador : chronologie et contexte Nouvelles
- 2 Institut des politiques migratoires : violence et migration Rapport de l'ONG
- 3 Banque mondiale El Salvador : données par pays Gouvernement/Données
- 4 The Economist : L'ascension de Nayib Bukele Nouvelles
- 5 InSight Crime : Analyse de la réduction de la violence Analyse de l'industrie
- 6 Reuters : État d'urgence au Salvador Nouvelles
- 7 AP : Arrestations massives et mesures de sécurité Nouvelles
- 8 Brookings : surveillance numérique et politique Académique
- 9 The Guardian : Analyse d'une méga-prison Nouvelles
- 10 Human Rights Watch : Détentions et procédures judiciaires Rapport de l'ONG
- 11 Statista : Statistiques sur les homicides au Salvador Données/Industrie
- 12 Amnesty International : Violations des droits humains sous l'état d'exception Rapport de l'ONG
- 13 NYTimes : Bitcoin Beach, nouvel pôle d'attraction touristique Nouvelles
- 14 NPR Latino USA : Analyse du taux d'arrestations Nouvelles
- 15 Nations Unies : Rapport sur les conditions de détention Rapport de l'ONU
- 16 Reporters sans frontières : Aperçu de la répression de la presse Rapport de l'ONG
- 17 Revue trimestrielle des Amériques : Changements judiciaires et démocratie Académique/Actualités
- 18 WOLA : Changement de criminalité souterraine Rapport de l'industrie
- 19 TechCrunch : Surveillance numérique au Salvador Industrie technologique